« Event Report » - journée d'études sur les communs numériques : bilan et perspectives
- Mael Roland
- il y a 6 jours
- 17 min de lecture

C’est à la suite d’un post LinkedIn de Sébastien Shulz , chercheur rencontré lors de ma participation au Symposium New Governance en juin 2025, que j’ai découvert la journée d’études Recherche sur les communs numériques : bilan et perspectives, qu’il coorganisait avec Sébastien Broca. Le programme résonnait avec mes recherche: y assister me permettait, au-delà de cet intérêt personnel, de vous en proposer un compte rendu analytique.
La journée se tenait à la Maison de la Recherche de l’Université Paris 8, à Saint-Denis. Arrivé la veille, le rendez-vous est fixé à 9 heures pour l’accueil autour d’un café ; l’introduction officielle débute à 9h30, en amphithéâtre MR 002. La journée d’études est structurée en deux temps complémentaires : une matinée consacrée au bilan critique des communs numériques, suivie d’un après-midi tourné vers les perspectives et les enjeux contemporains.
Pour préparer ce compte rendu, j'ai pris des notes tout au long de la journée et enregistré les différentes interventions afin d'en faciliter la retranscription et l'analyse ultérieure : et contrairement à la dernière fois, j'ai réussi mes enregistrements !
Les organisateurs
Sébastien Shulz est chargé de recherche en sociologie au CNRS. Ses travaux portent sur les enjeux politiques, économiques et environnementaux du numérique, en particulier à travers l’étude des communs numériques, de l’écologisation du capitalisme numérique et des relations entre communs et action publique. Impliqué dans le groupe de travail Politiques des communs numériques (Centre Internet & Société – CNRS) et cofondateur du Collectif pour une Société des communs, ses recherches articulent sociologie du numérique, économie politique et analyse des institutions. Dans ses publications récentes : La captation marchande du covoiturage en France (Réseaux, 2024) éclaire comment les politiques publiques d’écologisation de la mobilité ont renforcé le capitalisme de plateforme; Digital Commons for the Ecological Transition: Ethics, Praxis and Policies (Shulz, S., O’Neil, M. Broca, S., Daly, A., 2024, coécrit notamment avec Broca, propose une analyse critique des communs numériques à l’aune du capitalisme numérique, en interrogeant leurs conditions éthiques, politiques et matérielles de soutenabilité.
Sébastien Broca est professeur en sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris 8 et directeur du CEMTI. Ses travaux portent sur la numérisation des sociétés, la critique des Big Tech, les communs numériques et les transformations contemporaines du capitalisme numérique. Cofondateur de la revue EnCommuns et co-coordinateur du groupe Politiques des communs numériques, il est également l'auteur de Utopie du logiciel libre et de Pris dans la toile. De l’utopie d’Internet au capitalisme numérique (Seuil, 2025), qui analyse la capture progressive des idéaux émancipateurs du numérique.
Introduction : la triple filiations et les enjeux des communs numériques
La journée s’ouvre par une introduction assurée par les deux organisateurs, qui posent les principaux enjeux scientifiques et politiques de la rencontre. Sébastien Shulz introduit la journée par deux rappels structurants. Le premier est réflexif : dans le champ des communs numériques — comme l’illustrent les personnes présentes dans l’amphi — nombreux sont les acteurs « multi-positionnés », à la fois chercheurs, praticiens, militants ou experts, configuration contribuant à expliquer un champ de recherche qui évolue en parallèle de ses objets.
Ce constat fait écho à un second rappel : la généalogie du concept de commun numérique renvoie à trois grandes filiations, indispensables pour situer les débats contemporains. La première apparaît à la fin des années 1990, dans le contexte du premier capitalisme numérique et de ce que James Boyle a qualifié de « second mouvement des enclosures sur les ressources de l’esprit » : « les premières mentions qu’on a des communs numériques apparaissent en 98-99, par Laurence Lessig, qui utilise ce terme pour critiquer l’extension des droits de propriété intellectuelle sur les ressources informationnelles ». Les communs numériques sont alors pensés avant tout comme des ressources informationnelles en accès ouvert. L'approche sera largement relayée par des juristes comme J. Litman, Y. Benkler, L.Lessig, J.Boyle (Coriat et Broca 2015, p. 273), qui travaillent aux questions de codes sources ouverts et des licences libres (abordé dans ma thèse comme une des filiations de Bitcoin, Chap I, section 1, p. 66-67).
Une seconde filiation s’inscrit dans le prolongement des travaux d’Elinor Ostrom et de l'école de Bloomington. L’attention se déplace des seules questions d’accès vers celles de la gouvernance collective : les communs numériques, en particulier les communs de la connaissance, sont définis comme des ressources co-gouvernées par des communautés (c'est en partie cette approche que j'empreinte dans ma thèse pour analyser la gouvernance des CM, Bitcoin et Ethereum).
Une troisième filiation, plus critique et qualifiée de post-marxiste, s’intéresse moins aux régimes d’accès ou aux dispositifs institutionnels qu’aux pratiques de coopération et de «faire ensemble ». Le communing y est pensé comme une activité sociale et politique inscrite dans une critique plus large du capitalisme — perspective que Carlo Vercellone approfondira par la suite.
Ces trois filiations ne se succèdent pas de manière linéaire mais coexistent, s’entrecroisent et évoluent au rythme des transformations du capitalisme numérique.
Comme prolongement de ce cadrage, Sébastien Broca souligne trois déplacements majeurs qui reconfigurent aujourd’hui les débats : l’intensification des enjeux liés au travail et à la répartition de la valeur, notamment face aux dynamiques extractives de l’IA générative ; le retour des contraintes environnementales, longtemps minorées dans un univers pensé comme immatériel ; et enfin la montée en puissance de la souveraineté numérique comme horizon politique, dont les communs pourraient être à la fois un levier et une fausse piste.
C’est à partir de ce double cadrage — généalogique et critique — que s’ouvre la première conférence de la journée, confiée à Carlo Vercellone.
Carlo Vercellone — « Capitalisme cognitif et communs numériques »
J'étais heureux de retrouver Carlo Vercellone — et son accent charmant — cela m'a renvoyé à mes désormais lointaines années étudiantes à Nanterre. Son intervention, longue et dense, a structuré ma compréhension de la journée en posant un cadre critique, parfois frontal, sur la relation ambivalente entre communs numériques et capitalisme cognitif.
Vercellone part de définitions pour saisir la « dialectique complexe » entre communs numériques et capitalisme cognitif depuis la crise du fordisme. Sa première thèse est que le capitalisme cognitif (fin des années 1970–1980) se définit comme une tentative de sortie de crise du capitalisme industriel, surtout via une refonte des mécanismes de capture de la valeur face à l'essor des forces productives fondées sur la connaissance, le numérique et les « productions de l'humain par l'humain » (santé, culture, éducation). Il en résulte une dynamique de rente : extension de la propriété intellectuelle, financiarisation, privatisations et, plus récemment, capture des créations du commun par les plateformes, au prix d’une recentralisation d’Internet. Dans une hypothèse convergente avec Broca, Vercellone soutient que nous serions entrés dans un troisième stade — un capitalisme cognitif-informationnel — marqué par l’hégémonie du capitalisme numérique et par un extractivisme centralisateurs (cloud et IA).
Sa deuxième thèse — celle qui m'a le plus marqué — porte sur le commun comme mode de production. Contre les approches qui réduisent les communs à la nature des biens ou à des dispositifs juridiques, Vercellone se revendique d'une conception matérialiste d’inspiration opéraïste : le commun ne se définit ni par l’accès ni par la gouvernance locale, mais par des formes historiques d’organisation de la production fondées sur l’intelligence collective. Cette dynamique traverse l'ensemble des secteurs productifs et ouvre la possibilité d'une communalisation du public, c'est-à-dire une transformation interne des règles de gestion et de propriété selon les principes de l'autogouvernement. Il propose de « penser au sens de Marx, le commun comme un véritable système économique social en voie d'émergence, qui se développe au sein même du capitalisme et à partir de ses contradictions — parfois de complémentarité, mais aussi de subordination, de dépendance et de prédation ».
Vercellone propose ensuite une périodisation qui m'a particulièrement intéressé, en ce qu'elle romp avec les lectures déterministes d'un capitalisme numérique conçu comme un processus « sans sujet », entièrement façonné par la logique du capital. Il rappelle que la révolution informationnelle s’est d'abord construite sur une synergie entre contre-cultures et science ouverte, hors hégémonie marchande : « dans un premier temps, la logique ou l’esprit du commun a précédé, et en un certain sens poussé, le développement du capitalisme numérique ». C’est cette antériorité qui explique, selon lui une certaine naïveté, car l’âge d’or du logiciel libre a reposé sur une radicalisation de l’inclusivité — « l’absence de clauses de discrimination par rapport aux usages » — ouvrant la voie à trois failles majeures : l’autorisation d’usages contradictoires avec des finalités sociales (jusqu’au DRM) ; l’extractivisme avec « l’appropriation de logiciels libres comme ressources gratuites mises au service de l’accumulation du capital » ; et l’absence de dispositifs de rémunération sociale du travail, contraignant les communs à la dépendance financière. La montée du capitalisme de plateforme après 2000, puis de l’IA, sont dès lors non des ruptures, mais une exploitation continue et systématique de ces failles. Cela cristallisera la critique centrale discutée tout au long de la journée : les communs numériques ont-ils, malgré eux, préparé les conditions d’un capitalisme encore plus prédateur et extractif ?
Valérie Peugeot - «Puissance publique et communs numériques »
Valérie Peugeot se présente d'abord « en tant qu'activiste » avant d'être chercheuse et se voulant « à la fois lucide et en même temps positive », elle dit être en contrepoint du cadrage précédent. J'ai apprécié ce rééquilibrage : entre le travail de Carlo et celui de Sébastien [Broca], on avait l'impression « qu'en tant que commoners, on a été un peu les imbéciles naïfs du capitalisme cognitif ». Sans nier ce diagnostic, elle cherche à réencastrer les communs numériques dans l'écologie plus vaste des communs urbains, naturels ou de la connaissance et de leur relation à la puissance publique, afin de construire des coalitions plus robustes, nourries par des expériences historiques de résistance et de retrouver un horizon de long terme : «le système d'irrigation du peuple « Waro-Waro »,à côté du lac de Titicaca, a juste 8 milles ans ».
Elle rappelle que la puissance publique a toujours entretenu un rapport ambivalent aux communs, oscillant entre protection et destruction. La Charte des Forêts (1215) incarne une reconnaissance précoce des droits des commoners, tandis que les enclosures législatives du XIXᵉ siècle marquent au contraire une destruction organisée des communs par l’État. Ce détour historique permet de rappeler que la question des alliances avec la puissance publique — au cœur des débats contemporains sur les communs numériques — n’a rien de nouveau.
Elle en vient à distinguer trois cadres des communs selon leur rapport à l’État : l’approche institutionnaliste (Ostrom), d'un à côté de l'état et du marché ; l’approche fonctionnaliste (Rodotà), où communs et action publique sont plus hybride; et les courants opéraïstes, qui lisent l’État comme solidaire du capitalisme cognitif. Elle rappelle que, dans le contexte états-unien, les communs numériques se sont construits dans une culture profondément anti-étatiste, marquée par le libertarianisme (Déclaration du cyberespace de John Perry Barlow, 1996) et par la période post-Reagan de dérégulation, ce qui a facilité leur captation par les Big Tech. La trajectoire française apparaît plus hybride, avec un décloisonnement précoce vers d’autres communs (santé, écologie, ESS) et une implication directe de commoners dans l’action publique. À partir des politiques récentes, Peugeot identifie trois usages étatiques des communs — innovation, transformation de l’action publique, souveraineté — mais souligne leur fragilité et leur ambiguïté.
Reste une conclusion pragmatique : les communs ont besoin d’alliances avec l'ensemble des commoners comme avec la puissance publique, si on veut les inscrire «vraiment dans un projet politique progressiste de longue année ».
Félix Tréguer - « A l'heure du technofascisme, l'activisme numérique dans l'impasse? »
Félix Tréguer annonce qu'il va « être le boomer de la session », proposant moins une thèse qu’un bilan sur près de quinze ans d’engagement à La Quadrature du Net, marqué par la précarité militante et son départ cette année. Il dresse le « tableau d'un technofascisme qui monte, dans un environnement historique particulièrement adverse, avec une alliance inédite qui s'est nouée entre l'administration états-unienne et la Silicon Valley », qui a vidé de leur portée politique les luttes historiques des libertés numériques. Il parle moins des communs que de l'activisme numérique qui y est lié : cet activisme des années 1990–2000 a connu de réelles victoires (chiffrement, neutralité du Net), mais se retrouve aujourd'hui « acculé à multiplier les postures défensives » et à célébrer des « demi-victoires » procédurales, facilitant in fine la consolidation du capitalisme numérique : il a cite l' « arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2021, Big Brother Watch, contre Royaume-Uni », suites aux révélations Snowden en 2013, interrogeant le fait qu'un État qui respecte l'État de droit, puisse surveiller massivement les communications Internet .
Puis, il revient sur une série de combats emblématiques — chiffrement, neutralité du Net, lutte contre la surveillance de masse, partage non marchand de la culture, interopérabilité, réseaux alternatifs — afin d’en rappeler les conditions historiques de possibilité (alliances hétérogènes, structure d’opportunités favorable, capital technique militant) comme les limites structurelles (resserrement sécuritaire post-2001, centralisation industrielle, juridicisation des défaites).
Enfin, Tréguer reconnait être aujourd’hui plus lucide et critique (écologie, anticapitalisme), au prix d’une marginalisation politique et d’une perte d’influence sur l’action publique. Sa conclusion est pessimiste : si reconstruire des espaces de débat et de coalition apparaît nécessaire, au vu du contexte, « it’s probably going to get worse before it gets better ».
C'était la dernière présentation de la matinée, c'est la pause déjeuner.
Nathalie Casemajor - « Wikimedia Entreprise : l'entreprise des communs face au pouvoir relationel des plateformes. »
Nathalie Casemajor présente le lancement de Wikimedia Enterprise en 2021-2022, comme une rupture stratégique pour Wikipedia l' «ovni dans le monde des plateformes », étant « le seul site non commercial et autogéré dans le top 10 des plus grandes plateformes du web ». Elle rappelle que cette inflexion s’inscrit dans une double trajectoire historique : l'une renvoie aux tentatives de monétisation au début des années 2000 (publicité, partenariats commerciaux) et leurs échecs, provoqués par de fortes crises internes — notamment l’épisode du Spanish Fork — conduisant à leur abandon durable; l'autre, renvoie a la trajectoire de plateformisation progressive de Wikimédia, amorcée avec Wikidata (2012), qui a fait basculer le projet d’un corpus de textes vers une infrastructure de données structurées, interopérables et massivement réutilisées. Ce contexte pose des risques pour le communs, car les robots de moissonnage et l’IA générative exercent une pression sur l’infrastructure mettant en danger la soutenabilité économique et technique du mouvement : elle parle d’un « paradoxe de la réutilisation », où les modèles d’IA captent les données, mais aussi les parcours d’accès à la connaissance, en contournant Wikipédia comme point d’entrée.
Avec Entreprise, la volonté est de canaliser ces usages massifs, selon le principe de « vendre le tuyau, pas l’eau » : la donnée reste libre et distribuée entre les contributeurs, tandis que l’accès industriel à grande échelle est contractualisé via des API optimisées. Cette stratégie vise à sortir d’une posture défensive des communs face aux géants de la tech : en devenant fournisseur de services indispensables à l’IA générative (uptime, mises à jour en temps réel), Wikimédia stabilise des relations déjà asymétriques du fait « des relations de dépendance inégales ». Pour Brian Wyatt, c'est une traduction des communs « dans le langage du capitalisme »: pour éviter une tragédie des communs à la Hardin sans renoncer à la connaissance libre, il s’agit de parler aux géants du numérique dans leur propre idiome — celui du contrat et du service.
Le bilan est positif : en 2024-2025, Wikimedia Enterprise atteint 8,3 millions de dollars de revenus (+148 % sur un an), dégage un premier profit net et a déjà amorti son investissement initial, trois ans seulement après son lancement. Un plafonnement statutaire de ce revenu est institué à 30 % du budget afin de préserver l’indépendance du mouvement. Quant au scraping sauvage qui pesait sur la ressource commune il a été réduit substantiellement. Restent des tensions persistantes : risque de démotivation des bénévoles, opacité contractuelle liée au secret des affaires, dépendance partielle à AWS malgré une volonté de rester « cloud-agnostic », et renforcement du pouvoir de la Fondation au détriment de la gouvernance distribuée. L’enjeu central devient la redistribution de la valeur captée vers l’écosystème élargi des communs et du logiciel libre.
Table Ronde : Les relations entre communs numérique, État et marché : Jean Cattan (( responsable de la démarche nationale Café IA), Agnès Crépet (Fairephone), Arnaud Levy (noesya)
Cette table ronde réunit des acteurs de terrain et de l’action publique — Arnaud Lévy (noesya), Agnès Crépet (Fairphone) et Jean Cattan (secrétaire général du Conseil national du numérique) pour interroger les communs numériques à partir de pratiques concrètes.
Arnaud Lévy (noesya) propose de sortir de la figure de l’activiste isolé pour adopter une logique de guilde : faire corps autour d’un métier, de valeurs partagées et d’une organisation collective. Noesya revendique ainsi une activité tournée vers des acteurs publics et parapublics, précisément parce qu’un besoin réel existe : produire des sites sobres, accessibles, durables, sans dépendance aux infrastructures extractivistes du web industriel. Le commun n’est pas ici un retrait du marché, mais une manière située de produire, compatible avec un service public pensé hors logique de croissance.
Agnès Crépet (Fairphone) insiste sur leur présence industrielle comme levier politique. Fairphone agit dans les espaces de décision et de négociation, en démontrant concrètement que les contraintes invoquées par les grands acteurs relèvent de choix stratégiques: ils mettent « la tête des gros [acteurs industriels] dans leur caca» en prouvant techniquement que des alternatives (comme le bootloader unlockable) sont possibles. Cette capacité à « être dans la pièce » révèle une asymétrie centrale : seuls les acteurs capables de produire à l’échelle industrielle peuvent peser durablement sur les régulations.
Jean Cattan décrit le rapport à l’État comme fondamentalement ambivalent: il souligne la tension structurelle entre communs et institution étatique, tout en reconnaissant l’existence au sein d'administration, « de personnes [...] qui on fait le choix d'agir depuis l'État pour y déposer de petites flamèches ». Les expériences évoquées montrent cependant que la régulation reste un champ de lutte profondément inégal, dominé par les capacités de présence, d’expertise et de temps des grands acteurs industriels. Les communs ne peuvent s’y inscrire qu’au prix d’une structuration préalable.
Enfin, la discussion évite de dépasser toute technophobie. J'ai apprécié qu'Agnès rappelle avec force que le renoncement abstrait au numérique est socialement classiste : pour des publics précaires (sans-papiers, migrants), le smartphone reste un outil vital d’autonomie, d’accès aux droits et de lien social. Cette lucidité empêche toute posture de refus radical et plaide pour un alternumérisme concret, attentif aux usages réels. En écho, Arnaud souligne que le numérique constitue une « parenthèse » matérielle permise par un stock fini de ressources (cuivre, minerais), invitant à déplacer le rapport à la technologie d'une logique de puissance à un soin à conserver un environnement habitable. Cette attention aux conditions matérielles et sociales rejoint enfin l’enjeu politique de l’échelle locale : « si on pense au communalisme de Murray Bookchin, on peut se dire qu'à un moment on peut concevoir l'État comme étant une forme de gouvernance polycentrique de plein d'institutions à petites et plus grandes échelles » dont les communs.
Keynote Yochai Benkler : « Coopérativism in Capitalism : How was Marx wrong in The poverty of philosophy, and how was he right? »
La journée se clôt par une keynote à la fois attendue et symbolique : celle de Yochai Benkler, dont le nom n’est évidemment pas inconnu. Benkler fait partie de cette première génération de chercheurs états-uniens qui ont accompagné, conceptualisé et nourri l’émergence des communs numériques — la première filiation intellectuelle rappelée en ouverture de la journée par S. Shulz. Auteur clé de la notion de commons-based peer production, il revient avec honnêteté réflexive, sur vingt-cinq années d’espoirs, de malentendus et de désillusions politiques autour du numérique, prévenant que « le titre [est] trompeur, car il y aura très peu de discussions sur la pauvreté de la philosophie et Marx, et beaucoup plus d'introspection à la lumière de sa critique ».
Revenant sur la période fondatrice (1996–2006), il rappelle l’hypothèse centrale de la commons-based peer production : la diffusion massive des moyens matériels de communication (PC, réseau) devait rompre le lien historique entre propriété du capital et pouvoir asymétrique, ouvrant la voie à une production sociale décommodifiée, auto-organisée, située hors de l’État comme du marché. L’ambition était de construire une infrastructure commune fondamentale — informationnelle, juridique et technique — permettant une coexistence stable entre production marchande et production sociale commune.
Benkler reconnaît toutefois qu’il sous-estimait la dynamique propre du capitalisme. S’il identifiait bien une « compétition écologique » entre communs et propriété, il concevait encore cette lutte comme essentiellement technopolitique : un projet « plutonien », misant sur l’action directe par l’architecture technique et juridique plutôt que sur la conquête du pouvoir politique. Or, à partir de 2008, un tournant s’opère : iPhone, cloud computing, plateformes fermées et recentralisation du capital marquent une phase de ré-enclosure massive, que son optimisme premier l'avait empêché d'anticipé. Le capital ne combat pas frontalement l’ouverture ; il la contourne, l’absorbe et la reconfigure. Les communs ne disparaissent pas, mais leur langage et leurs pratiques sont soumise à une éthique extractive, où la subversion première est capturée et le langage de la coopération est subvertit par celui de la performance : un « changement radical, passant de la production entre pairs au crowdsourcing, du partage à l'économie collaborative, et essentiellement à un travail précaire, le Wi-Fi et la communauté Wi-Fi finissant par être utilisés comme un outil marketing efficace par les opérateurs télécoms en place ».
Ce moment révèle, selon Benkler, son erreur de ne pas avoir de véritable théorie du capitalisme: il à « pris conscience que le projet auquel nous nous consacrions depuis une vingtaine d'années était fondamentalement proudhonien, soumis précisément aux limites que Marx avait identifiées dans sa critique ». Là où Marx avait raison, c’est en montrant que le capitalisme n’est pas un choix moral ou institutionnel, mais un ensemble de relations sociales historiquement contraintes, structurées par la dépendance au marché pour la subsistance. La « dynamique de la Reine Rouge » désigne pour Benkler un capitalisme où l’on est contraint de courir sans cesse — vendre sa force de travail et ses produits sur le marché pour simplement survivre —, la recherche de positions de pouvoir (faiseur de prix) devenant le moteur même du changement technologique et de ses puissantes forces créatrices. Dans ce contexte, le volontarisme proudhonien — qu’il identifie dans ses propres travaux — ne peut suffire : « le problème fondamental réside dans les impératifs des forces sociales, et non dans le volontarisme des idées justes [car] nous ne pouvons pas simplement choisir de nous comporter différemment et de penser différemment. » On ne transforme pas une société capitaliste par de « bonnes pratiques » isolées, car le système produit en permanence de nouvelles formes d’appropriation, de domination et de « technologies de pouvoir » (déqualification du travail, capture des désirs, asymétries statutaires).
De ce constat découle un déplacement stratégique net. Benkler esquisse alors une voie explicitement programmatique fondée sur la recherche d’une « liberté réelle », entendue comme affranchissement durable vis-à-vis des impératifs marchands. À rebours des illusions volontaristes, il soutient que cette liberté suppose une attaque institutionnelle frontale contre la dépendance au marché : décommodifier partiellement les besoins fondamentaux (logement, santé, énergie), et socialiser les marchés clés du travail, du savoir et du crédit. Concernant l’intelligence artificielle, il plaide pour un déplacement stratégique : ne plus se limiter à la régulation, mais investir publiquement dans des infrastructures d’IA, afin d’offrir aux coopératives et aux organisations non capitalistes un accès bon marché à la puissance de calcul, condition matérielle de leur autonomie.
Cette perspective conduit Benkler à réaffirmer sans ambiguïté la centralité de l’État. Il n’existe, selon lui, aucune échappatoire par le bas : sans prise sur le pouvoir politique, les communs restent structurellement vulnérables aux dynamiques de ré-enclosure capitaliste. La démocratie n’est pas l’état naturel du capitalisme: elle « ne peut être réalisée qu'au prix d'une lutte constante contre l'attraction gravitationnelle de l'oligarchie, qui est la tendance naturelle du capitalisme ». Si les coopératives et les communs jouent un rôle essentiel d’« équilibreurs de charge » face aux excès du marché, ils ne sauraient remplacer une transformation programmatique des fondations institutionnelles du capitalisme lui-même.
Benkler conclut que la fenêtre d’ouverture qu’a constituée l’internet des origines est refermée. Les communs numériques ne peuvent survivre durablement sans s’inscrire dans un projet politique explicite de transformation des fondations institutionnelles du capitalisme. Il n’existe pas d’échappatoire par la seule vertu technique ; il n’y a pas de substitut à la lutte politique organisée : il faut « avant tout partager la même conception du capitalisme, à savoir qu'il est non seulement extrêmement productif, mais aussi extrêmement déstabilisateur, qu'il n'est pas purement abstrait, que ce soit au sein des sociétés ou à l'échelle mondiale, entre les économies pauvres et les périphéries, entre le nord et l'est » afin sans quoi, nous nous laisserons « entraîner dans la spirale du capitalisme ».
Conclusion
Je conclurais la recension de cette journée dense par quelques réflexions plus directement liées à mes propres recherches et interrogations.
Lors des échanges de Vercellone avec la salle, j’ai tenté — peut-être maladroitement — d’introduire une question qui traverse mon travail : celle des crypto-monnaies comme dispositifs possibles de soutenabilité économique des communs numériques (dont il sont eux-même des répresentants). En évoquant les crypto-monnaies sans plus de précision, je pensais en réalité à Ethereum, aux ICO et aux tokenomics associées aux tokens de gouvernance, c’est-à-dire à des outils permettant à des communautés de logiciels libres de se financer, de salarier des équipes et d’administrer collectivement du capital humain et financier en dehors des circuits bancaires classiques.
La réponse apportée — recentrée sur Bitcoin, son extractivisme énergétique et sa trajectoire spéculative — a surtout mis en lumière la persistance d’une lecture négative et largement indifférenciée des crypto-monnaies, au prix d’un effacement des expériences hétérogènes qui s’y déploient. À l’inverse, l’échange avec Nathalie Casemajor m’a paru particulièrement fécond : en prolongeant son analyse de Wikimedia Enterprise, la discussion a ouvert la possibilité de penser des mécanismes de paiement ou de tarification de l’usage des infrastructures elles-mêmes (scraping, bots, accès intensif aux données), faisant implicitement écho à une intuition centrale du Web3 (j'avais rappeler l'émergence du standard crypto x402): ces infrastructures apparaîssent alors comme une Common pool ressource, au sens ostromien, dont la soutenabilité suppose une gouvernance et des arbitrages socio-économiques situés.
Ce décalage m'a aussi fait prendre conscience que ma question initiale était peut-être mal posée. Il ne s'agit pas seulement de savoir si les cryptomonnaies peuvent financer les communs numériques, mais de reconnaître qu'elles sont elles-mêmes des communs numériques — avec leurs protocoles ouverts, leurs communautés de développeurs, leurs modes de gouvernance expérimentaux et leur jetons. À ce titre, elles sont un terrain d’expérimentation profondément ambivalent, où se rejouent — parfois de manière brutale — les tensions discutées tout au long de la journée : les dynamiques de capture et de subordination les traversent, sont amplifiées parfois, les ICO, les tokenomics, les DAO rejouent à leur manière les tensions entre ouverture et ré-enclosure, entre autonomie collective et capture par le capital financier, entre innovation institutionnelle et reproduction des rapports de domination. Mais elles constituent peut-être un laboratoire particulièrement visible de ces tensions, précisément parce qu'elles mêlent infrastructure technique, gouvernance collective ET mécanismes économiques explicites — rendant ainsi plus lisibles les 'failles' identifiées.
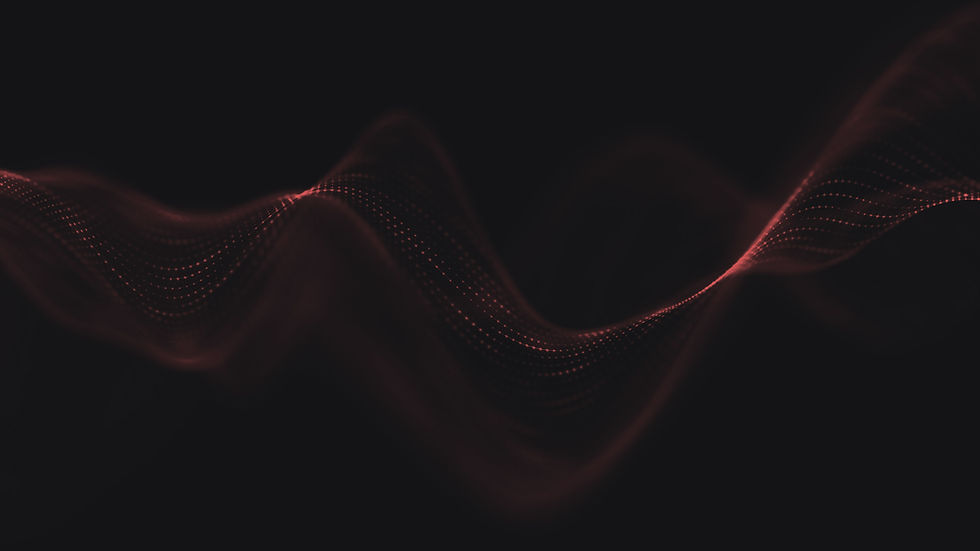



Commentaires